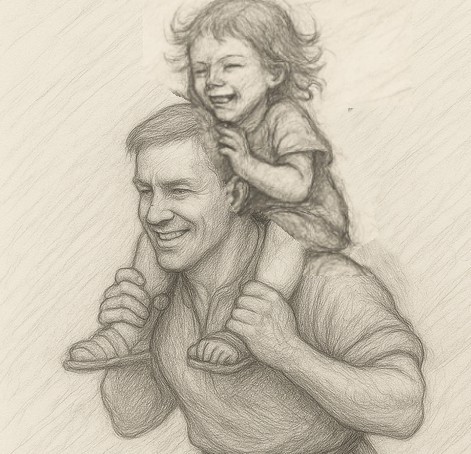(exemplaire masculin)
Je me réveille, j’ai un peu la tête dans le cul. J’ai bossé tard, presque jusqu’ à minuit et je suis rentré claqué. Le bureau était désert, c’était calme et j’ai pu avancer sur le projet. Pour le coup, j’ai mis une alarme pour me réveiller bien qu’on soit samedi, parce que j’ai rendez-vous à dix heures, avec les X-men. Ça me fait encore sourire ce surnom qu’on s’est donné… les X-men.
Xavier, Maxime et Alexandre, nos trois prénoms. Avec des x, tous les trois. On s’est connu pendant nos études, on jouait à l’AS Rugby de la fac. Xavier était en licence de droit, Maxime entamait une maîtrise de chimie, quant à moi, j’attaquais ma troisième année en école d’architecture. On est rapidement devenus potes, on l’est resté.
Maxime est devenu prof. Il officie maintenant dans un lycée à Montpellier, il vient à peu près une fois par mois pour voir ses parents. Xavier bosse dans un cabinet d’avocat à Bordeaux, il a fait sa vie là-bas, il ne revient plus très souvent dans la région, mais chaque fois qu’il vient, nous réunissons les X-men.
Pas de séance d’abdo ni de pompes, ce matin. Juste une douche, j’enfile un jean, chemise et un blouson. On a rendez-vous au bar, notre bar. En fait, c’est plus un café qu’un bar. Il est situé près de la Grande Plage tout au bout du parking, c’est devenu notre QG. Sa terrasse est sympa au printemps, mais presque intenable l’été, malgré les parasols. Il est presque neuf heures et demie, il faut que j’y aille. Je rafle mon portefeuille et mon trousseau de clefs dans l’entrée, je file.
J’arrive le premier, Xavier arrive trois minutes après moi, et Maxime nous rejoint presque immédiatement. Poignées de mains, embrassades et claques dans le dos. Jean, le garçon, attiré par nos exclamations de retrouvailles surgit. Jean n’a pas d’âge, il me semble l’avoir toujours connu. Il ne change pas. Peut-être un peu moins de cheveux et un peu plus de rides, mais toujours le même gilet noir, aux multiples poches, son long tablier blanc noué autour de la taille, un plateau rond juché sur trois doigts, attributs de sa fonction. Il nous salue avec cordialité puis s’enquiert : « Et qu’est-ce ça sera pour ces messieurs ? » avec le même ton cérémonieux dont il use avec tous les clients. Le grand style, quoi. Il passe un coup de lavette sur la table, bien que celle-ci n’en ait nul besoin, la repose sur son plateau, repart dans le café, commande à l’adresse du patron d’une voix de stentor : « Un thé au lait ! Un expresso ! Un grand crème ! »
Nous parlons avec vivacité, chaque anecdote échangée nous arrache des éclats de rire. Jean dépose notre commande sur la table. Xavier, un instant interrompu, reprend :
« Alors le type me dit tout de go : « Maître, flanquer une gifle à cet abruti s’apparentait à de la légitime défense ! » Pour une fois, je suis resté bouche bée. » Nous nous esclaffons.
Une femme avec un chien tenu en laisse s’approche et s’installe, le raclement de sa chaise nous a fait tourner le regard dans sa direction. Petite, brune, dans les quarante ans. Elle s’est assise dos au soleil presque en diagonale de nous, mais de l’autre côté du passage.
Maxime, grand célibataire devant l’Éternel, nous annonce tout-à-trac qu’il a trouvé « la bonne » et qu’il compte se marier. Combien de fois avons-nous eu droit à ce genre de proclamation définitive de la part de Maxime. Nous le charrions, il fait semblant d’être en colère, proteste « Non, non, je vous assure, les gars ! ».
Jean a déposé un grand crème sur la table de la femme. Elle mord dans un croissant. De temps en temps, elle jette discrètement un coup d’œil vers nous. Ça me fait sourire. Elle a beau faire ça très discrètement, faire semblant d’admirer le rivage, elle nous regarde chaque fois que nous éclatons de rire, puis replonge le nez dans sa tasse. Tasse qui doit être vide depuis le temps. Bientôt, elle se lève et entre dans le bar. Elle ressort. Et en bons mâles que nous sommes, mariés ou pas, célibataires ou non, nous nous taisons lorsqu’elle passe, la raccompagnant du regard jusqu’à sa place.
Nous reprenons nos propos badins, nos galéjades, nos blagues nulles. J’aime beaucoup nos rendez-vous X-men, ces sont des moments de bien-être, de légèreté, les soucis disparaissent, les habituelles préoccupations qui nous alourdissent s’allègent. Je ne saurais définir exactement ce qui se passe, mais on se sent bien, et nous savons que les deux autres ressentent la même chose.
La femme donne un bout de croissant au chien, le gratifie d’une caresse, elle lui dit quelque chose que je n’entends pas, le chien remue la queue et cela me fait sourire. Elle lève la tête et surprend mon regard, mon sourire. Je détourne le regard. J’ai raté le début de l’histoire que nous raconte Maxime, une histoire d’ions et de cations, d’élève qui ne comprend rien. Je jette un nouveau coup d’œil à la femme, puis reporte mon attention sur mes deux compagnons, je ne sais pas si elle a vu que je la regardais. Maintenant, c’est elle qui me jette un nouveau coup d’œil, que je fais mine de ne pas remarquer. C’est un peu comme si nous jouions au jeu de la barbichette, par coups d’œil interposés, ou à cache-cache.
Nous nous apprêtons à partir, Xavier s’empare de la note. Nous protestons par principe. C’est chaque fois la même chose. Nous reproduisons la scène avec presque les mêmes mots, mais nous savons tous trois, qu’à la fin, c’est Xavier qui paie, en moquant les salaires de l’Éducation Nationale pour ce qui est de Maxime, et m’assurant qu’il me laissera payer la prochaine fois. Jean surgit, Xavier lui tend un billet, Jean lui rend la monnaie en fouillant dans les poches minuscules de son gilet. « Bonne journée, messieurs, à la prochaine ! ». Nous nous levons, nous allons quitter la terrasse, lorsque je me ravise, je fais signe aux deux autres que je les rejoins. Ils se tiennent, pour une fois, ne partent pas en rigolant, ne font pas de commentaires. J’en suis surpris. Mais les commentaires, je sais que je vais y avoir droit, accompagnés de sourires entendus, une fois que je les aurai rejoints.
Je m’approche de la table occupée par la femme, je me baisse et caresse le chien, je lui chatouille les côtes. C’est une espèce de Border, noir avec le bout de la queue et le bout des pattes blancs. Le museau est blanc aussi. Pas un pur race. J’ai eu un chien comme ça quand j’étais tout petit. Il s’appelait… il s’appelait… comment s’appelait-il ? « Tobbie ! ». Son nom presque oublié a surgi de ma mémoire.
« Comment s’appelle-t-il ?
– Pouki » me répond-elle en riant presque.
Je peux la regarder enfin de près. Elle est jolie mais ce n’est pas une beauté. Ses yeux noirs sont expressifs. Elle doit avoir dans les 40 ou 45 ans.
Elle enchaîne :
– Je sais, ça ne ressemble à rien comme nom pour un chien, pas que pour un chien d’ailleurs, c’est un nom parfaitement ridicule » Elle rougit et je trouve ça charmant.
« Pouki » redit-elle et elle soupire. Un soupir résigné ? Désabusé ? Je ne sais pas.
« Eh bien, Pouki, dis-je en m’adressant au chien, je suis très heureux de faire ta connaissance. Je m’appelle Alexandre, mais tous mes amis m’appellent Alex. »
Elle ne répond rien, se contentant de hocher la tête
Je caresse une dernière fois le chien et me relève. Je la regarde et lui souris. Elle me sourit aussi mais ne dit rien.
« Je dois y aller, et je désigne d’un mouvement de la tête mes deux amis qui m’attendent. Enchanté d’avoir fait la connaissance de Pouki. »
« Punaise, elle aurait pu me dire au moins son prénom. » Pensé-je. Je suis un peu déçu, je me sens complètement idiot.
Je pose mon trousseau de clefs sur le meuble de l’entrée, me déleste de mon portefeuille. Mon blouson atterrit sur l’accoudoir du canapé, et je me laisse tomber sur ledit canapé, la tête posée en arrière sur les coussins. J’ai trop mangé comme chaque fois qu’on se réunit avec les X-men. Le resto sur le port… Il y avait des fruits de mer, ça, ça va encore, mais la copieuse choucroute de la mer m’a été fatale, d’autant qu’on l’a accompagnée de deux bouteilles de blanc et d’un dessert par là-dessus ! Pas raisonnable. Je ferme les yeux quelques minutes, pas trop longtemps sinon je vais m’endormir… Je repense à la femme-au-chien. Je ne peux pas la désigner autrement, vu qu’elle ne m’a pas dit son prénom. Ça m’agace, qu’elle ne m’ait pas dit son prénom, je ne sais pas exactement pourquoi ça m’agace, mais ça m’agace.
C’est vrai quoi, ça n’engage à rien d’échanger des prénoms.
Je vais dans la cuisine, je me sers un verre d’eau, je le bois devant l’évier et m’en ressers un immédiatement.
Je revois la scène. Moi, qui fais de l’humour en me présentant au chien, elle qui sourit juste.
Ça m’agace. Non, c’est Elle qui m’agace.
Remarque, elle est peut-être très timide, ou très prudente, ou peut-être qu’elle a été échaudée par tous les mecs qui lui ont demandé son prénom quand elle buvait un crème à la terrasse d’un café. Je ricane.
Elle est peut-être mariée. Non, j’ai pas vu d’alliance à sa main. Ou alors, elle n’en porte pas.
Ou alors, elle a cru que je draguais son chien.
Les idées les plus farfelues me viennent en tête. Maintenant je rigole tout seul.
Faut que je pense à autre chose. Ça ne sert à rien d’émettre des hypothèses sans fin. Elle ne m’a pas dit son prénom, point barre.
Dommage, parce que…
Mais, punaise, qu’est-ce que ça aurait changé, que je sache son prénom ? J’allais pas lui filer rencard.
Quoique…à bien y réfléchir…REFLECHIS PAS !! Alex, ne réfléchis pas, mon garçon, tu te fais du mal !
Je tends la main vers le livre qui est sur la table basse.
Brautigan. « Le général sudiste de Big-Sur ». Le temps de retrouver la page où j’en suis resté, mon esprit s’échappe deux ou trois fois vers la femme-au-chien. Qui de Brautigan ou de cette femme va l’emporter ? Je me concentre, lis une page ou deux, éclate de rire. Brautigan est vraiment très fort…
Je lis et ne m’interromps que pour avaler un yaourt. Ça suffira. Avec ce que j’ai mangé ce midi, je suis incapable d’absorber plus. Je reprends le livre. Je n’ai repensé à-la-femme-au chien que trois fois en mangeant mon yaourt. Brautigan, donc.
Vers 22 heures, je vais me coucher, je suis crevé en fait. J’ai eu une grosse semaine, ai travaillé tard presque chaque soir, et ce matin, le rendez-vous X-men m’a privé de ma rituelle grasse matinée. Au bout de cinq minutes au lit, j’éteins la lumière.
C’est à ce moment que les choses se corsent.
Dès que j’éteins la lumière, je repars en boucle. J’imagine ce qui aurait pu se passer si… si elle m’avait dit son prénom, si nous avions échangé quelques mots, si j’avais été seul au bar ce matin, libre de m’attarder, si…, si…, si…Bref, je brode inutilement en me jouant les différentes versions de ce qui aurait pu être. Mais qui n’a pas été. Je peux me les jouer à l’infini, ça ne changera en rien ce qu’il en est. A part m’empêcher de dormir. Merde à la fin ! Je me tourne et me retourne dans le lit, toutes les trois minutes. Sois constructif, mon petit Alex. Étudie le projet. Le cahier des charges. Réfléchis aux plans possibles. Raisonne sur les contraintes de matériau, c’est ton boulot, au moins ça tu sais faire ! Bon, alors, je sais que j’ai envie de la revoir, je ne sais pas trop pourquoi. Ça mériterait d’être éclairci. Elle m’a plu ? Je ne me souviens plus vraiment de son visage, déjà. A part de ses yeux noirs. Deux billes de jais. Non, ce qui m’a plu, ce sont ses sourires quand elle nous regardait, ses petits coups d’œil en coin, sa façon d’être avec son chien et qu’elle rougisse quand elle m’a dit le nom de son chien en bafouillant.
Je ne suis pas complètement honnête sur ce coup-là. Quelque chose m’a plu. Si ça avait été un mec ou si elle avait eu 60 ans, je ne serais pas là à réfléchir, je l’aurais oubliée, je ne serais probablement même pas allé jusqu’à sa table. Conclusion, quelque chose m’a donné envie d’aller à sa table pour lui parler. Bon, on avance. Laborieusement, mais on avance. J’ai eu envie d’en savoir plus, de savoir ce qu’elle pensait de nous, de nos éclats de rire, pourquoi cela avait tant suscité son intérêt, oui, c’est ça, envie de savoir ce qui lui avait traversé la tête. Envie de mieux la connaître. De faire sa connaissance au sens propre. Stricto sensu, comme le dit ma mère.
Étape suivante. Comment je peux rattraper le coup ? Il faudrait d’abord que je la retrouve et à part au bar, je ne vois pas où. Elle n’est pas du coin, je ne l’ai jamais vue, ni croisée. Ni elle ni son chien. Ce doit être une vacancière. Une vacancière, ici ? Au mois de février ? Ou alors, elle n’est là que pour le week-end. Je repousse l’idée.
Donc, seule solution, retourner au bar avec un bouquin, attendre et espérer qu’elle y revienne aussi. Faible chance de réussite, mais seule possibilité. En plus, si elle revient, c’est sans doute un bon point. Elle espère peut-être m’y retrouver… ou pas. Ou pas.
Qu’est-ce que je fais si elle vient ? Comment je m’y prends pour l’aborder à nouveau ?
Et je propose quoi ? On reste au bar jusqu’à sa fermeture ? On devient amis en vingt minutes ?
Et on décide de ne plus jamais se quitter ? Je passe à la bijouterie de garde et j’achète une bague de fiançailles que je lui offre négligemment ?
L’idée me fait ricaner.
Sois sérieux, Alex. Bon, alors, qu’est-ce que je lui propose ?
Je retourne dans ma tête la question, je sèche un peu. Soudain, l’idée fuse. Je la trouve brillantissime. Enfin, disons pour être exact, que c’est la seule que je trouve possible à mettre en pratique un dimanche matin.
Une promenade et un pique-nique ! Avec un chien comme le sien, elle doit passer des heures à se promener. Et aimer ça. Sinon, il fallait qu’elle prenne un Yorkshire.
Donc demain matin, direction le bar. Seule contrainte, mettre le réveil à sonner.
Je peux faire une croix sur ma grasse matinée du matin. Parce que, si ça se trouve, elle est matinale.
Je ferme les yeux et je m’endors en deux minutes.
J’arrive en vue du bar, évidemment j’ai oublié de prendre mon bouquin…La matinée risque d’être longue. Mais quand j’arrive sur la terrasse, j’avise immédiatement le chien couché dont la laisse est glissée sous un pied de chaise et une grande tasse vide sur la table. Je suis instantanément : soulagé, content, un peu inquiet de savoir ce qui va se passer, de comment je vais m’y prendre pour ne pas apparaître comme un gros lourd, un dragueur de seconde zone.
Elle n’est pas là, elle doit être à l’intérieur.
Le chien semble m’avoir reconnu, il se lève, s’étire comme le font les chiens, et bat de la queue frénétiquement. Sa maîtresse fait alors son apparition. Je la regarde puis m’adresse au chien :
« Salut Pouki, ça va ce matin ? Tu as l’air en forme ! Ta maîtresse, en revanche, a une mine abominable, elle a eu un réveil difficile ? Elle est de mauvaise humeur ? »
Je me relève et je me fends du sourire le plus malicieux possible.
« Réveil difficile ou mauvaise humeur ? » Bon, c’est tout ce que j’ai trouvé comme entrée en matière. Pas terrible. Je continue sans lui laisser le temps de répondre.
« Pouki, lui, a l’air de très bonne humeur, il ne demande qu’à faire une longue promenade. »
Peut-être un peu trop rapide. Je ne sais pas du tout ce qu’elle pense. Je tire une chaise à moi.
« Je peux ? »
Là, je prends le risque qu’elle me réponde non. De quoi j’aurais l’air ? Parce que dans mon « super-plan », je n’ai pas envisagé un seul instant la possibilité qu’elle n’ait pas envie de me voir, ou de parler avec moi (et plus si affinités). Je me pose là, comme fin stratège.
Mais bon, elle acquiesce et le petit rire qui suit, me rassure.
Je continue mon manège en m’adressant à Pouki.
« Tu vois, elle va déjà mieux, je suis certain que d’ici une minute, elle va réussir à articuler trois mots. »
Je n’en suis pas si certain que ça, en fait. Alors, j’enchaîne :
« Alors, vous êtes d’accord pour faire une grande promenade avec Pouki et moi ? » Je continue presque d’une traite :
« On peut acheter des sandwiches et deux petites bouteilles d’eau, et improviser un pique-nique. Ça vous dit ? »
J’y vais fort là. Mon empressement est pathétique. Elle va me prendre pour un dingue, pour un psychopathe, même, si ça se trouve. D’autant qu’elle ne répond rien, comme si elle prenait plaisir à me voir me débattre lamentablement avec ma proposition à la noix.
Elle articule alors trois mots.
« Ca-me-va » TROIS MOTS ! Si ça se trouve elle cherchait une réponse en trois mots pendant que j’étais suspendu à son verdict. Sous son air de sainte Nitouche, c’est une maligne en fait.
Je pars acheter des sandwiches, des bouteilles d’eau.
Je me rends compte que je ne sais toujours pas son prénom.
Je la laisse finir son café pendant que je vais acheter les sandwiches. En fait, j’achète de quoi faire des sandwiches et Marie me les fait. Je connais Marie depuis, voyons… je ne sais pas depuis quand en fait. Dans mon esprit, je l’ai toujours connue. C’est elle qui tient la supérette. Elle n’est plus très jeune. Non, elle est même carrément vieille. A dix ans, j’allais déjà acheter mes bonbons chez elle. Alors je suis un peu comme son chouchou. Un de ses chouchous, disons plutôt. Toujours est-il, que lorsqu’elle voit ce que j’achète, elle lève les sourcils.
« Tu vas faire un pique-nique, alors ? » me demande-t-elle, curieuse comme une pie, avec un sourire plein de sous-entendus. Je hoche juste la tête, avant de répondre :
« Mais comme ce n’était pas prévu, j’ai rien préparé, alors… »
Avant que je finisse ma phrase, elle s’empare de mes achats, disparaît dans l’arrière-boutique. J’entends le bruit d’un couteau à pain puis deux minutes plus tard, elle réapparaît tenant un petit sac plastique qu’elle me tend.
« Bon pique-nique ! » Je la remercie d’une bise sur la joue.
« Eh ! Tu me raconteras ? » demande-t-elle d’un air malicieux au moment où je franchis le seuil de sa boutique.
Nous marchons sur la petite route à l’ombre des pins et des chênes-verts, celle qui commencent à l’extrémité du parking.J’en connais chaque détail. Je l’emprunte souvent. Elle longe le littoral à quelques centaines de mètres, puis s’élève sur la falaise. Ça ne monte pas trop, on peut de temps en temps apercevoir la mer en contrebas, à la faveur d’une trouée dans la végétation. Il y a un endroit vraiment sympa où grignoter un pique-nique et faire une pause : une espèce de dalle rocheuse, qui offre une vue sur la mer à 180 degrés. Et puis, il y a le « lotissement-fantôme » et la cabane perchée de mon grand-père.
Pouki trotte devant nous à quelques dizaines de mètres, reniflant et levant la patte, comme tous les chiens.Je m’arrête un instant :
« Vous savez que je vous ai surnommée « la-femme-au-chien » ? » Elle s’arrête à son tour et fixe son regard dans mien avec l’air de ne pas comprendre. Puis elle écarquille un peu les yeux. Et quels yeux ! Les deux billes noires qui semblent pouvoir me sonder. Punaise, quand cette femme vous regarde, elle vous regarde ! Sortant de ma contemplation, j’articule :
« Je ne connais toujours pas votre prénom. Je ne vais tout de même pas faire un pique-nique avec une inconnue ! »
Elle rougit un peu -décidément, elle est adorable quand elle rougit- se mord un instant la lèvre inférieure.
« Oh ! Je ne voulais pas me monter impolie, vous savez… c’est vrai que je n’ai pas pensé à le faire… excusez-moi ! »
Puis enfin, elle prend une inspiration, puis dans un souffle :
« Sandra… Je m’appelle Sandra ».
Nous discutons de tout et de rien.Des raisons pour lesquelles, elle est arrivée là, du cabanon qu’elle a loué. Je vois parfaitement où cela ça se situe, pas génial, mais à l’écart, et à cette période plutôt calme. Nous avançons d’un bon pas. Les chênes-verts et les pins maritimes se mélangent désormais aux buissons d’épineux. Ceux-ci prennent chaque année plus d’ampleur et s’étalent désormais sur les bords de la petite route. La surface de bitume semble se gondoler, soulevée par les racines des arbres.
Nous marchons côte à côte, Sandra est obligée de se rapprocher de moi ; la route est moins large.
Je compte l’emmener d’abord au « lotissement fantôme » comme les gens du coin l’appellent. Des vestiges d’un club de vacances de cinquante maisons qui est finalement mort-né. Un défaut de permis de construire a tout fait capoter. Mais pour le coup, ce sont cinquante maisons à tous les stades de construction. C’est un endroit assez fascinant. Bien sûr on a pillé ce qui pouvait l’être, ou bien on a cassé. Les tagueurs, tels des insectes nécrophores, venus en dernier, y ont apporté la touche au saccage final. Il règne une ambiance irréelle dans « le lotissement fantôme ». Même moi, je ne suis pas insensible à cette ambiance. Des friches industrielles, les bâtiments désaffectés, les entrepôts ou les locaux d’usine, les anciens hôpitaux, j’en vois une trentaine par an. Cela fait partie de mon boulot. Je travaille dans un cabinet d’urbanisme spécialisé dans la réhabilitation de friches, justement. Le cabinet propose des projets clefs en main aux municipalités ou aux communautés de communes qui les ont rachetées pour une somme généralement symbolique. Mon cabinet propose une sorte de « pack » comprenant : la réfection du bâtiment, les réseaux, la voirie pour y accéder, et même l’aménagement des espaces verts. On travaille sur appel d’offres. Gros budgets, mais gros boulot aussi. En gros, on fait tout, l’étude d’impact, étude de terrain, de la viabilité du bâtiment, ensuite on propose des plans, selon ce que le bâtiment est destiné à devenir. Plus exact de dire, je fais l’étude d’impact, l’étude de structure, les plans de la réhabilitation, je travaille aussi parfois avec les architectes des Bâtiments de France, quand le bâtiment en dépend. J’adore mon job, c’est souvent passionnant, varié, mais c’est terriblement chronophage. Je suis toujours à la recherche de temps, toujours à la bourre, en gros toujours en train de bosser, même certains week-ends quand on est proche de boucler un projet.
La route s’incurve, nous y sommes. Sandra est saisie par le lieu, elle reste immobile puis commence à explorer, elle visite tout, elle entre, elle sort des maisons, observe. Je lui explique ce qu’il s’est passé et elle se rembrunit. Elle me questionne sur le promoteur. Elle devient songeuse.
Nous quittons le lotissement, nous revenons sur nos pas. Il y a une bifurcation, une piste continue à longer le littoral en contre-haut, nous nous y engageons.
C’est là que Sandra explose, comme si elle avait besoin d’évacuer un trop-plein de sentiments.
« Les alentours sont un cauchemar architectural, cette agglomération est le comble de l’abomination ! Comment les gens ont-ils pu accepter qu’on construise ces horribles immeubles, ces résidences « clapier en béton », ces hectares de lotissements ? Tout ça pour du fric, par appât du gain ? ». Elle s’enflamme et pour un peu je crois qu’elle pourrait en pleurer de colère.
« Avons-nous tous vendu notre âme ? Et jusqu’où irons-nous ? »
Je ne dis rien. Elle se tait. Une minute ? Deux ? Un silence s’installe. Elle reprend d’un ton indigné, presque hargneux.
« On devrait obliger les architectes à vivre dans leurs constructions ! » s’exclame-t-elle.
« Et hop, une pierre dans ton jardin, mon petit Alex ! ». Difficile pour moi d’ignorer sa remarque et de passer à un autre sujet. D’autant que je ne suis pas complètement en désaccord avec elle. Je ne sais pas dans quelle mesure je suis disposé à défendre la profession dans son ensemble. Je suis d’ordinaire plutôt sévère avec mes propres confrères, mais réaliste sur les contraintes qui pèsent sur notre métier. La jungle des appels d’offres, les budgets hyper-contraints, les diktats des promoteurs qui veulent toujours rogner sur ci ou sur ça, bref…
Comment est-ce que je m’y prends avec la petite Sandra ? Je vais pas m’embarquer dans une polémique stérile. Bon, je balance mon pavé, en réponse à sa pierre, et je verrai bien ce qui se passe.
Nous marchons encore une centaine de mètres.
« Je suis architecte. » dis-je d’un ton calme.
Elle cille, rougit un peu, je peux presque voir les ondes circulaires du « pavé » onduler sur elle. Elles s’étendent au fur et à mesure qu’elle comprend l’étendue de sa gaffe involontaire.
C’est délicieux. Je vais la laisser mariner un peu, puis enfoncer le clou. Je me tais. Après quelques instants j’ajoute d’un ton amusé :
« Et circonstance aggravante, sans doute à vos yeux, je bosse dans un cabinet d’urbanisme. »
Je continue avant qu’elle ne puisse dire quoi que ce soit :
« Mais avant que vous me clouiez au pilori, j’ajouterai pour ma défense et celles de mes confrères, que c’est un cabinet spécialisé en réhabilitation de friches industrielles notamment. C’est la municipalité qui nous a mandaté pour la déconstruction, la remise en état et la re-végétalisation de ce lieu. Évidemment, je ne m’occupe pas du chantier, ce n’est pas ma partie. »
Tout cela dit d’un ton parfaitement urbain, dépourvu de toute animosité. Du grand art. Dans le style « vierge outragée » mais digne.
Je souris intérieurement. J’ai presque pitié d’elle. J’imagine toutes les pensées qui doivent s’agiter sous son crâne.
Nous continuons à marcher en silence. Au bout de quelques instants, elle s’arrête et murmure d’un air contrit :
« Je vous dois des excuses. »
Puis elle enchaîne plus fort :
« Je vous dois toutes mes excuses, vraiment. Si je vous ai offensé, sachez que je le regrette, que je suis résignée à faire amende honorable, et que même… » Elle cherche ses mots
« Vous pouvez me priver de sandwich. » pirouette-t-elle, comme si par ce trait d’humour, elle faisait reddition.
Je lui saisis délicatement le bras, juste au-dessus du coude, et imprime deux ou trois pressions pour lui signifier que tout va bien, que je ne lui en veux pas et qu’elle est pardonnée.
Peut-être laissé-je ma main au contact de son bras plus de quelques instants qu’il n’est nécessaire. Je continuerais bien à marcher comme ça, ma main tenant son bras. Mais je la retire malgré tout. A contrecœur.
Nous recommençons à marcher. Peu à peu, la tension s’apaise. Elle recommence à me parler de tout et de rien : de son chien, de ses vacances ici, d’une amie qui est venue dans la région, de son plaisir à faire de longues marches : « Je fais souvent des randonnées ». Je l’écoute, demande des précisions parfois, mais la scène que nous venons de vivre me retraverse l’esprit constamment, et je ne peux m’empêcher de sourire quand j’y repense. Elle surprend mes sourires à deux ou trois reprises. Elle penche alors son visage sur le côté en relevant alors un coin de la bouche. C’est une petite grimace très expressive qui semble me demander : « Quoi ? qu’est-ce que j’ai dit ? Qu’est-ce qui vous fait sourire ? ».
Quelques centaines de mètres plus loin, le sentier devient beaucoup plus étroit. A peine assez large pour que nous puissions y marcher côte à côte. Nos mains se frôlent, nos bras se heurtent.
Sans réfléchir ou en y réfléchissant tropau contraire, je lui prends la main. Depuis trois minutes, j’en avais envie, mais je l’ai fait sur une impulsion. Un passage à l’acte, quoi. Elle ne dégage pas sa main, ne semble même pas surprise, n’interrompt même pas sa phrase. Puis elle se tait, semblant apprécier le contact de sa main dans la mienne.
La petite piste descend maintenant et l’on peut apercevoir la dalle rocheuse où j’ai l’intention de nous faire pique-niquer.
Sur le chemin du retour, je prends à nouveau sa main. Sa peau est tiède sous mes doigts et je ressens un sentiment de sérénité, de plaisir calme, de contentement.
Sandra m’apprend qu’elle est traductrice pour des maisons d’édition qui ont des collections «de littérature étrangère », qu’elle est interprète aussi de temps en temps, à Genève.
Elle me parle aussi de sa famille : père russe, mère grecque qui ne lui ont parlé que le russe ou le grec, le français qui est la sienne en dehors de sa famille, avec pour résultat une petite fille qui était parfaitement trilingue, quadrilingue si on y ajoute l’anglais appris plus tard. Sandra m’assure que ça lui a semblé naturel de s’exprimer en trois langues durant son enfance, pas quelque chose de difficile ou d’artificiel. Rien d’extraordinaire selon elle, rien que de très banal.
Elle m’explique qu’en vérité elle s’appelle Cassandra, pas Sandra. Un peu trop grec, à son goût, trop tragique. Cassandre qui n’était jamais crue, dont les prévisions ne servaient à rien…
Je l’écoute, je pose des questions, mais je ne dis pas grand-chose de moi.
Je l’entraîne sur un sentier étroit sur la gauche. Sa main toujours dans la mienne, Sandra est juste derrière moi dans la montée, Pouki sur les talons. Elle trébuche sur une racine. Ma main s’affermit sur la sienne pour l’empêcher de tomber. Après quelques pas chancelants, en déséquilibre, elle se rétablit. Le sentier est très étroit. De part et d’autre, les buissons d’épineux s’accrochent à nos vêtements.
« Attendez, il faut que je vous fasse voir quelque chose. » Et je lui désigne du bras la cabane sur pilotis, à peine visible dans le haut de la végétation.
« Là ! juste au-dessus des arbres ! Vous voyez ? »
Non, de toute évidence, elle ne voit pas.
Je passe alors derrière elle. Juste derrière elle. Je me baisse un peu pour me retrouver à sa hauteur, je passe mon bras gauche tendu que j’appuie son épaule, pose l’autre main sur sa hanche droite pour l’amener dans le bon axe. Puis je pointe l’index.
« Et là ? Suivez la direction de mon doigt, vous ne voyez toujours pas ? »
Elle hoche vigoureusement la tête :
« Si, si, maintenant, je la vois, murmure-t-elle, elle est adorable !
– C’est mon grand-père qui l’a construite. Nous irons la voir de près la prochaine fois. »
Nous faisons demi-tour, l’air est plus frais maintenant, le soleil commence à décliner. Lorsque nous atteignons le parking où est garée sa voiture, le soleil est en train de se coucher.
Mon téléphone sonne. Je le sors de ma poche. Je compte bien ne pas le laisser m’interrompre. Mais un coup d’œil sur l’écran m’en dissuade. Punaise ! C’est Audrey !
« Excusez-moi, mais il faut que je réponde. » dis-je d’un ton soucieux.
D’une mimique, Sandra me fait comprendre qu’elle comprend.
Je prends donc ce maudit appel, je me mets à marcher à grand pas.
« Le moment n’est pas bien choisi, Audrey ! Les filles vont bien ? » Je suis toujours inquiet pour les filles lorsque Audrey m’appelle.
Audrey est mon ex. Huit ans de mariage. Un divorce très houleux, mais je présume que tous les divorces le sont. L’étalage de nos griefs et de nos récriminations respectives. La batailles d’avocats pour la garde des filles, pour l’attribution de la maison, bref, un divorce…
« Bon, qu’est-ce que tu veux ? » Je ne rajoute pas « encore » pour ne pas envenimer les choses. J’arpente le parking à grands pas.
Audrey m’explique qu’elle a un problème de garde, que son planning est surchargé, qu’elle doit se déplacer pour un rendez-vous professionnel.
« Mais punaise, Audrey tu as TOUJOURS un problème de garde ! » aboyé-je dans le téléphone.
« Tu as TOUJOURS un planning chargé. Et tu me sollicites TOUJOURS au pied-levé, la veille pour le lendemain, le matin pour le soir. Si c’est ton planning, t’es au courant un petit peu à l’avance, non ? Ca sert pas à ça, un planning ? »
Audrey et moi pratiquons une résidence alternée avec les filles. Une semaine, une semaine. Du vendredi au vendredi. Un peu contraignant comme mode de garde mais au final satisfaisant pour les filles et pour moi. Le « moins pire » disons. Je les ai déposées vendredi soir chez leur mère, on est dimanche, et dès ce soir, Audrey me demande de les prendre pour deux jours, elle les récupérera, à la sortie de l’école mardi, m’assure-t-elle. Punaise ! C’est toujours la même chose. Pendant cette conversation, je jette des coups d’œil vers le coin du parking où se trouve la voiture de Sandra. Elle a fait grimper le chien dans le coffre après lui avoir donné à boire, elle a ouvert la portière côté conducteur, elle s’est assise mais a laissé la portière ouverte et maintenant elle attend.
Audrey continue à mener son offensive de pilonnage. Je finis par me rendre. Je raccroche. Je suis d’une humeur massacrante, maintenant.
« Je suis désolé, un imprévu, il faut que je parte… » Je souris mais ça doit être plus une grimace qu’autre chose. « Je suis désolé ». Et c’est vrai, je suis particulièrement désolé.
A son tour de faire une petite grimace, elle incline la tête pour acquiescer. Elle est déçue, cela se voit. Elle met le contact de la voiture. « Ce n’est pas grave… Vous êtes tout excusé, voyons… ».
Je manque de lui expliquer mais renonce. Il faudrait alors tout lui expliquer. Je donne une impulsion sur la portière, elle se referme. Sandra a un moment d’hésitation puis démarre. Sa voiture s’éloigne.
Au bout de quelques secondes, je pousse un rugissement rageur : nous n’avons ni l’un ni l’autre pensé à échanger nos numéros de téléphone.
Le lendemain j’ai une journée de fou, entre les filles et le boulot en retard, je ne vois pas le jour. Au bureau, je suis complètement charrette sur deux projets, il faut que je récupère les filles à l’école, et que je fasse des courses, le frigo est vide quasiment. Je n’avais pas prévu qu’elles soient là.
Sandra tourne sans arrêt en arrière-plan dans mes pensées. Je compte passer au « village des pêcheurs », évidemment, mais aujourd’hui, c’est juste impossible, je ne peux pas, pas la possibilité matérielle, pas le temps. Je grince intérieurement.
J’ai passé une nuit de merde, je me suis réveillé je ne sais pas combien de fois.
Je dépose les filles à l’école, je file au bureau, et ce soir, je vais peut-être, enfin, réussir à remettre la main sur Sandra et rattraper le coup. Peut-être…J’ai demandé à madame Ferrière, la nounou, de récupérer exceptionnellement les filles à l’école, ça me laisse un peu de temps.
Le « village des pêcheurs » c’est près de trois cents bungalows…Ma voiture enfile les rues, les unes après les autres, je cherche sa voiture. Si ça se trouve en vain si elle est partie quelque part. Plan B, recommencer demain matin de très bonne heure. Enfin, je repère sa voiture sur l’emplacement devant un bungalow. J’appelle, je ne vois pas le chien, je me colle le nez sur la vitre de la porte fenêtre. Personne. Elle doit être en train de promener Pouki. Alors je sors l’enveloppe que j’ai préparée avec dedans une carte de visite du cabinet d’urbanisme où j’ai écrit mon numéro de portable au verso. J’ai même prévu le scotch pour fixer l’enveloppe sur le pare-brise de sa voiture. Je rentre chez moi, la balle est dans son camp, je n’ai plus qu’à attendre son éventuel coup de fil.
J’attends. J’attends. Rien. Je suis impatient et mon humeur s’en ressent. Les filles m’agacent, avec leurs cris, leurs galopades, leurs sollicitations incessantes. Je ne suis pas autant disponible pour elles qu’à l’ordinaire, elles le ressentent et me le font payer… C’est quasiment l’enfer. Je cède à tout ou au contraire, je pique une crise d’autorité, c’est selon le moment…
« Mais punaise, pourquoi est-ce qu’elle n’appelle pas ? Elle n’a pas trouvé mon mot ? Elle n’en a pas envie ? Je n’y comprends rien. Elle est en colère ? Elle n’ose pas ? J’ai raté un truc ou quoi ? Je me suis mépris, j’ai mal interprété ce qui s’est passé entre nous pendant la promenade ? Ce que j’ai pris pour les signes d’une mutuelle attirance n’en étaient pas ? Je me suis imaginé un truc qui n’existait pas ? »
Les filles hurlent dans le couloir, je me précipite pour les séparer. « Bon sang, Léa, lâche ta sœur ! »
C’est alors que j’entends le téléphone sonner. Téléphone que j’ai posé pour intervenir et faire cesser la bagarre. Je me rue alors dans le salon, décroche à la cinquième sonnerie.
« C’est Sandra. » souffle-t-elle d’une toute petite voix.
Toute ma tension retombe. Toutes mes interrogations disparaissent. Tous mes doutes s’apaisent.
« Ah ! Sandra ! j’espérais votre appel.
– Écoutez, Alexandre, je… » A nouveau des cris, de Lucie, cette fois, le bruit d’un objet qui tombe, puis des rires. Sandra s’interrompt. Je couvre le téléphone de la main, pour intimer aux filles de se calmer. « Les filles, vous allez dans votre chambre, immédiatement ! » Un silence relatif revient.
« Écoutez, je ne voulais pas vous déranger en famille… je… je suis désolée. » reprend-elle. Quelque chose dans son ton me laisse supposer qu’elle est tentée de raccrocher, alors très vite, j’enchaîne et débite d’une seule traite :
– Vous ne me dérangez nullement, au contraire. J’ai Léa et Lucie exceptionnellement. Nous pratiquons une résidence alternée pour les filles. Une semaine sur deux. Mais c’est une des spécialités de mon ex d’avoir des « empêchements » et de me demander de les garder au pied levé. C’est pour cela que j’étais énervé, dimanche, après son coup de fil. Je vais les mettre au lit, d’ailleurs, et je vous rappelle… presque tout de suite. » Et je ris, d’un rire de collégien attardé.
Je raccroche.
C’est d’un pas allègre que je me rends dans la chambre des filles. Je trouve soudain qu’elles sont adorables, charmantes et presque obéissantes, ces gamines. Quand elles sont en pyjama et couchées, je prends le temps de leur lire une histoire. Pas une longue, quand même… J’ai hâte de pouvoir rappeler Sandra.
Nous marchons sur la route au milieu des chênes verts et des pins maritimes, la main de Sandra dans la mienne. J’en savoure la tiédeur. Nous discutons de tout et de rien. Elle me raconte son divorce. Je lui raconte le mien. C’est presque banal, anecdotique. Pouki trotte devant nous comme à son habitude. Nous bifurquons dans le sentier qui mène à la cabane. Elle attache Pouki au premier barreau de l’échelle. Elle s’engage alors et commence à monter, elle n’a pas l’air trop assurée. Je me place juste derrière, prêt à parer un déséquilibre, une chute éventuelle. Nous atteignons la plate-forme, je sors la grosse clef de ma poche que j’introduis dans la serrure. La porte résiste un peu comme d’habitude, mais je sais où donner les quelques coups de la hanche qui la feront céder. J’adresse un clin d’œil à Sandra, puis m’efface, la laissant entrer la première. Elle embrasse la pièce d’un regard circulaire. Elle a l’air subjuguée. Moi, je connais la cabane depuis que je suis tout petit, elle ne me surprend plus, mais j’ai une idée de l’effet qu’elle peut produire quand on la découvre. Le regard de Sandra balaie l’ameublement sommaire : la table, le réchaud, le fauteuil et la chaise, la lampe à gaz, le lit. Elle s’approche pour observer nos vieilles photos en noir et blanc qui sont punaisées sur les murs, petits clichés de vacances. Elle passe un doigt sur la tranche des livres, en déchiffre le titre : Ivanhoé, Croc–Blanc, Vol de nuit, Le hussard sur le toit. Elle ne dit rien, mais il me semble qu’elle est émue. Son regard s’attarde quelques instants sur la table, avec les deux cahiers, les stylos-plumes, les crayons de couleurs. Elle me regarde.
Puis elle observe le lit, recouvert d’un plaid écossais à frange. Je lui raconte « l’histoire du lit » grand moment épique resté dans la mémoire familiale.
« Et quelle comédie pour hisser le lit, ça a été ! Mon père avait attaché le sommier à une longue corde, la rambarde faisait palan, mon père et mon grand-père poussaient et tiraient le lit à partir de l’échelle. Et nous les enfants, en bas, et mon père qui s’emportait : « Mais ne restez pas en dessous, bon dieu, s’il tombe il va vous écraser ! » Ça a été un grand moment ! » Je ris en me souvenant de la scène.
Je vais m’asseoir sur le lit et je lui ouvre les bras.
Nous faisons l’amour lentement.